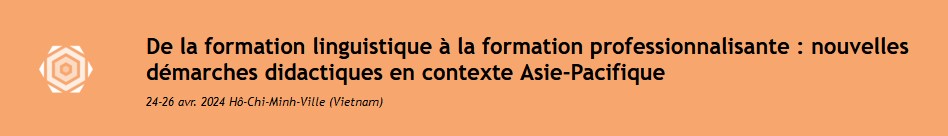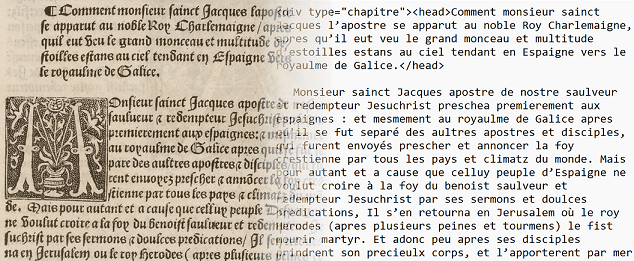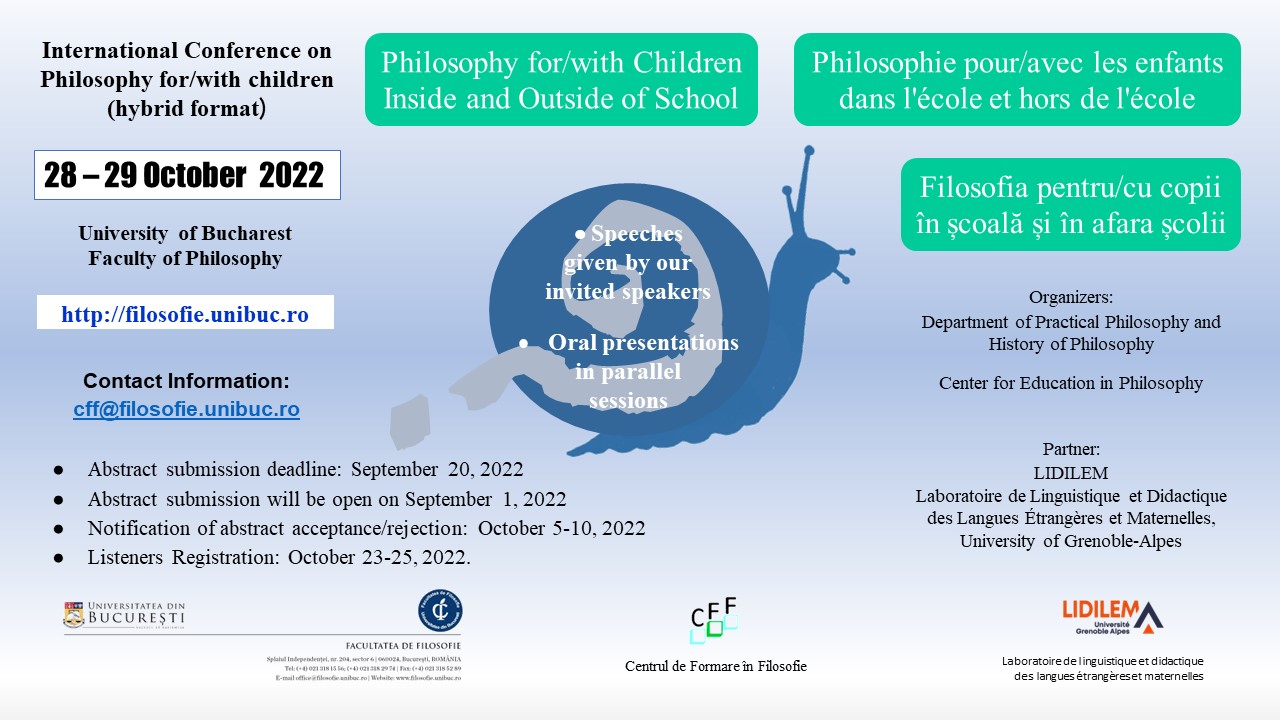Colloque
Du 18 mai 2022 au 20 mai 2022
La haine est un sentiment puissant, alimenté par des émotions négatives telles que la colère, la honte, le mépris et le dégoût. Elle exprime avant tout la volonté du sujet d’anéantir physiquement et/ou symboliquement un⋅e autre, objet de sa haine, allant parfois jusqu’à la destruction de soi dans une volonté sacrificielle, comme pour les actes terroristes. Mise en discours (Lorenzi Bailly et Moïse 2021), la haine peut être observée comme une forme saillante de tensions sociales entre personnes, entre groupes, entre idéologies, entre représentations, entre pratiques ; une forme saillante également de processus de domination sociale et de discriminations – étant dirigée, dans ses aspects les plus systémiques, contre des groupes minoritaires.
De nombreuses disciplines des sciences humaines étudient le discours de haine. Les sciences du langage, par exemple, s’intéressent à différentes dimensions de la haine mise en mots dans l’espace social (Petrilli 2020) ou à travers les réseaux sociaux (Ferrini et Paris 2019, Stassin 2019). Dans la lignée des discours sur le hate speech (Baider, Millar et Assimakopoulos 2019), et dans une visée politique, certaines recherches portent sur la performativité des discours de haine (Butler 1997, Lorenzi Bailly, Määttä et Romain 2021) et sur leurs conséquences sociales, tout en tenant compte des rapports de groupes, de leurs dimensions idéologiques et contextes d’énonciation. D’autres travaux s’intéressent plus spécifiquement à circonscrire ce qui caractérise un discours de haine, que l’on soit dans un « discours de haine directe » (Lorenzi Bailly et Moïse 2021), ou dans un « discours de haine dissimulée » (Baider et Constantinou 2019). En ce sens, les neurosciences peuvent être d’un apport significatif pour circonscrire le mécanisme cognitif de la haine : par exemple, la théorie des neurones miroirs qui participent des émotions et des sentiments (Rizzolatti et Sinigaglia 2008), de la haine donc, mais a contrario également du développement de l’empathie, notamment par la production d'ocytocine (Seltzer, Ziegler et Pollak 2012) ; ou encore les travaux sur la dynamique neuronale de l’interaction imitative synchrone (Dumas 2011). Citons enfin les innombrables travaux concernant le rôle du système limbique dans les émotions, positives comme négatives. Dans une autre direction, en droit et philosophie du droit, la notion de discours de haine est appréhendée dans sa tension avec la liberté d’expression (Hare et Weinstein 2009), droit fondateur de la démocratie dont le statut et les limites externes varient selon les traditions juridictionnelles (Zoller 2008). Des travaux soulèvent les frontières poreuses séparant les discours de haine des actes expressifs tels que l’offense ou le blasphème, qui participent du débat démocratique ; des études se penchent sur les rôles de la législation dans la régulation de ce dernier (Girard 2014), la responsabilité de la jurisprudence dans la multiplication des crimes de haine lorsque les discours de haine ne sont pas prohibés (Ross 1995), ou encore la responsabilité du droit de protéger la « dignité sociale » des membres de certains groupes (Waldron 2012). D’un autre côté, depuis une perspective historique, les discours de haine s’inscrivent dans des contextes socio-politiques à chaque fois spécifiques qui les alimentent et les favorisent (périodes de crises, de guerre ou de bouleversements sociaux, changements sociaux et législatifs…). Les recherches en histoire ont donc montré que la haine est productrice de discours situés et qu’elle structure l’espace public, son discours prenant une fonctionnalité politique (Deleplace 2009, Buton 2009). Nonobstant, les tentatives de régulation démocratique de la haine telles que la loi Pleven en France peuvent disposer de contre-effets : nolens volens la loi du 1er juillet 1972 a joué un rôle crucial dans la modernisation des extrêmes droites (Lebourg et Beauregard 2012). De leur côté, les sciences sociales et politiques ont récemment pris pour objet les problématiques liées à la haine en rapport avec l’immigration, la radicalisation et les discriminations raciales (Hajjat et Mohammed 2014, Jansen 2011). Dans le cadre du djihadisme, la production d’une propagande haineuse sert certes à la radicalisation individuelle mais également à unifier idéologiquement une mouvance transnationale (Crettiez 2016). Des études de terrain sur les radicalités et les réseaux de sociabilités, notamment dans les quartiers populaires, cherchent aussi à déconstruire les discours sur l’émergence de la haine en posant un regard complexe, nuancé, sur ces formes de production et leur circulation (Zegnani 2018). Cette circulation de la haine ne relève pas d’une contagiosité mécanique : l’analyse des réactions aux attentats de 2015 dévoile ainsi que, si certes des groupes se polarisent, d’importants mécanismes de résilience et ralliement à la norme démocratique existent (Faucher et Truc 2020).
Cinquante ans après l’adoption de la loi Pleven à l’unanimité le 1er juillet 1972, qui a instauré le délit d’incitation à la haine dans le droit français, ce colloque se veut un espace de réflexion interdisciplinaire sur l’objet « discours de haine ». Il appelle des contributions venant notamment, et de façon non-exhaustive, de l’histoire, du droit, des sciences politiques, de la linguistique, des neurosciences, de la sociologie et de l’anthropologie. Ces contributions pourront s’inscrire dans un ou plusieurs des axes suivants :
Axe 1 : approches du discours de haine dans sa diversité disciplinaire
Nous souhaitons donner une place importante à une démarche théorique et définitoire des discours de haine afin d’étudier ce qui fait leurs spécificités, que les définitions soient légales, jurisprudentielles, historiques ou discursives : le discours de haine est-il une catégorie générique et englobante, ou doit-il être dissocié clairement de notions connexes ? Est-il nécessairement historicisé ? Une définition d’un tel objet peut-elle être interdisciplinaire ? Ou, au contraire, des définitions se déploient-elles à l’intérieur d’un champ disciplinaire circonscrit ? De façon générale, cet axe questionne la scientificité et l’opérativité de la notion dans différentes disciplines des sciences sociales.
Axe 2 : éthique et responsabilités de la recherche dans leur approche du discours de haine
Cet axe invite à penser l’acte de définir le discours de haine comme un geste performatif qui situe éthiquement les recherches au-delà d’un point de vue normatif ou moral. Au-delà des intérêts épistémologiques que la notion de discours de haine peut revêtir, cet axe interroge donc également les conséquences non seulement épistémologiques, mais également éthiques, déontologiques, politiques, sociales, pratiques, du maniement scientifique d’une telle notion. La responsabilité de la recherche est alors convoquée dans la définition d’une notion liée à des enjeux démocratiques de liberté d’expression et de censure. On pourra voir aussi quels sont les enjeux éthiques et épistémologiques liés à Internet et à l’intelligence artificielle, aux développements techniques et constructions socio-technologiques, dans leurs dimensions politique, économique, sociologique, juridique et technologique (rôle des réseaux sociaux, désinformation, biais de l’intelligence artificielle, etc.)
Axe 3 : discours de haine, inégalités et luttes sociales
La question des discours de haine dans la complexité interactionnelle et sociale de leurs usages peut être traitée du point de vue individuel/personnel en analysant des corpus d’interactions d’individus légitimes où le lieu d’énonciation/locution est (re)connu. Ces discours peuvent néanmoins être produits par des institutions ou par les « appareils idéologiques de l’État » – participant en cela à la production et à la reproduction d’inégalités et de processus de domination. Comment alors traiter les discours de haine quand ils sont systémiques, structurels, étatiques et institutionnels ? Comment aborder les discours de haine quand ils sont le fruit d’un discours juridique, religieux, politique dont la source énonciative n’est pas connue ? Y a-t-il des sources légitimes de discours de haine ? Comment évaluer la responsabilité des hébergeurs de sites à l’égard des messages postés dès lors qu’Internet est devenu un espace public de discussion légitimé ? Comment les discours de haine actuels convoquent-ils le passé et à quelles fins ? Les discours de haine s’observent aussi à l’intérieur des discours militants qui dénoncent la haine. Comment alors traiter ces contradictions et ces phénomènes de miroir quand la haine est utilisée pour contrer la haine ?
Axe 4 : discours alternatifs et contre-discours
Cet axe souhaite questionner la production discursive qui lutte contre le discours de haine : quels contre-discours existent, quels discours alternatifs existent ? Comment fonctionnent ces deux catégories ? Peut-on les différencier ? Quel rôle joue la jurisprudence dans ce domaine, la Cour européenne des droits de l’homme ? Les contributions peuvent être fondées sur des réflexions théoriques, par exemple sur le rôle de la recherche comme productrice de discours alternatifs, critiques, d’interprétation, d’explication du réel (discours politiques, controverses sociales, tensions et raideurs, guerres, violences humaines).
Axe 5 : Aspects pratiques de remédiations
Poser la question de la remédiation, comprise dans son sens premier comme « remède à », c’est poser le rôle de la recherche comme action sociale et, plus largement, celle des citoyen∙nes dans la société. Quelles sont les réponses juridiques et leurs limites ? Existe-t-il des pratiques de remédiation ou des dispositifs mis en place face à la haine, en lien, par exemple avec les apports des neurosciences, voire de la psychologie cognitive, déjà appliqués aux soins thérapeutiques comme la transe cognitive (Flor Henry et al. 2017), ou avec les apports de l’argumentation déjà mobilisés dans les ateliers philosophiques ? Plus largement, comment créer un discours de remédiation, vérifier son efficacité et le diffuser à large échelle ? Quelle est la place de la création artistique ?
Partenaires

Modalités de contributions
Nous attendons des propositions de communication de 350 mots (à l’exclusion des références), comprenant vos noms, prénoms et affiliation universitaire, à l’adresse suivante : discoursdehaine2022 gmail.com (discoursdehaine2022[at]gmail[dot]com).
gmail.com (discoursdehaine2022[at]gmail[dot]com).
Les résumés doivent être envoyés dans une des quatre langues suivantes : anglais, espagnol, français, italien. Les présentations le jour du colloque pourront se tenir dans n’importe quelle langue et devront s’accompagner d’un support visuel en français ou en anglais.
Les formats de contribution innovants, créatifs ou/et ludiques seront bienvenus et valorisés.
Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 1er novembre 2021 ; les retours des évaluations s’effectueront à partir du 15 janvier 2022.