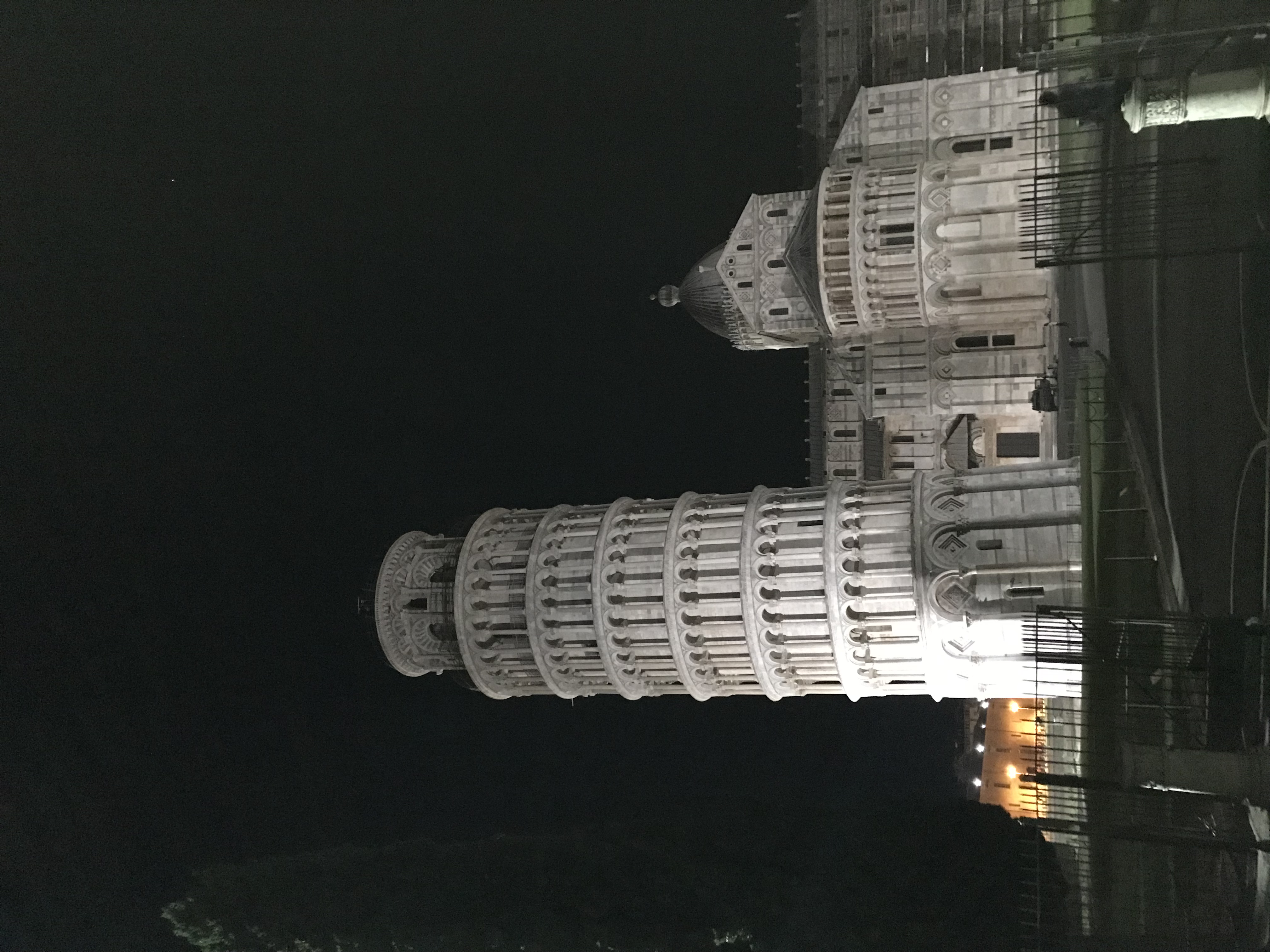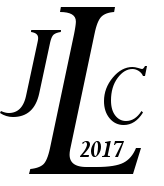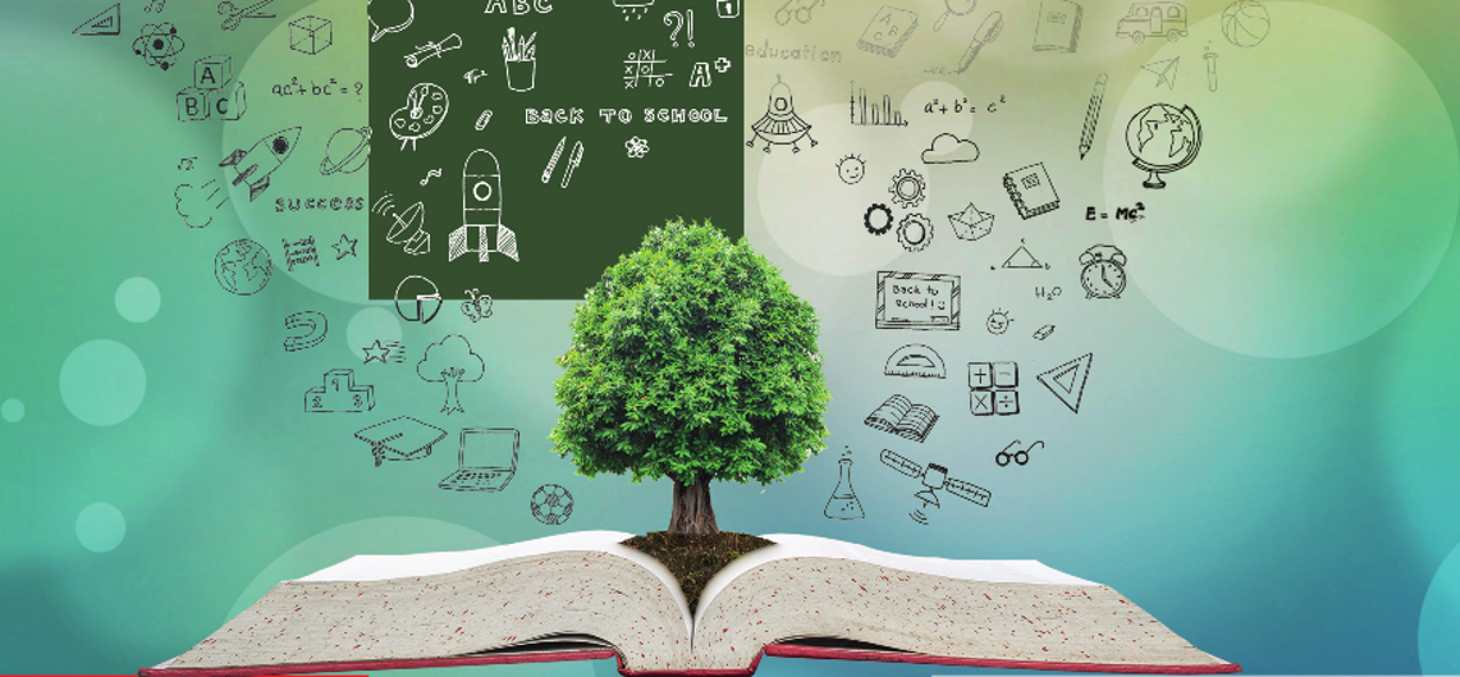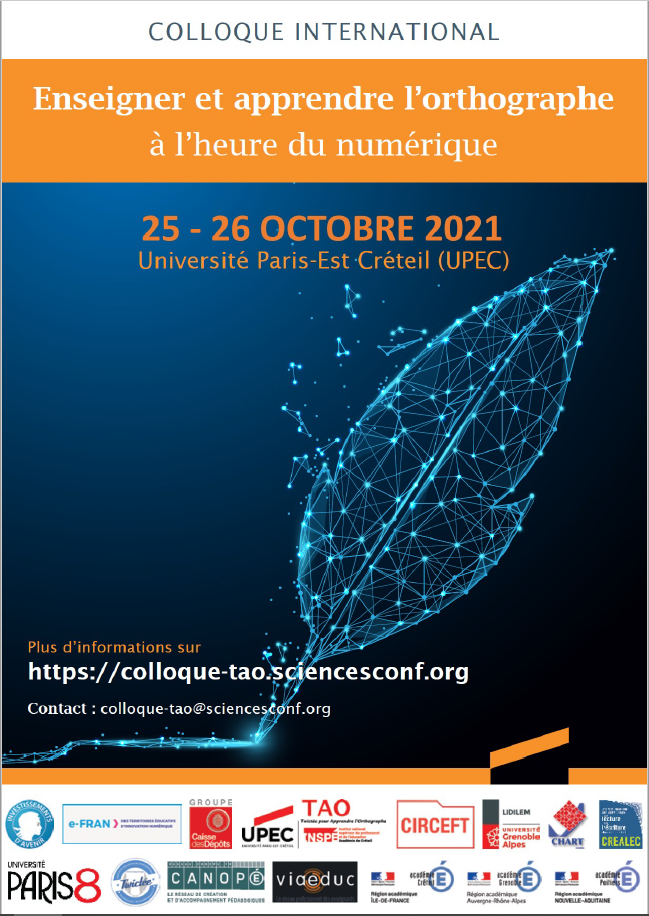L’avoir, le garder, le perdre, le prendre - Accent : perspectives sociolinguistiques (APS22)
Accent, notion introuvable ?
L’accent constitue une catégorie de perception qui parle à tout le monde mais qui reste très difficile à définir de façon univoque. Ainsi, pour R. Lippi-Green (2019 [2012] « [l]es linguistes ont peiné à trouver une définition exacte du mot accent, et pour la plupart y ont mal travaillé ».
Si l’accent a longtemps été considéré comme une notion de sens commun et dès lors dépourvue de pertinence en linguistique et même en dialectologie, il en va autrement depuis le début du siècle, où une partie des professionnels de la réflexion en sciences humaines (sociologues, anthropologues, (socio)linguistes...) n’essaie plus de marquer à tout prix la différence entre leur savoir savant et le sens commun, mais font entendre leur voix de spécialistes à côté de celles des usagers et des médias. En témoigne, par exemple, l’importance prise ces deux dernières décennies par les études de linguistique folk, les études critiques et les réflexions méthodologiques sur la perception, les représentations, en lien avec les questions d’apprentissage, de sécurité/insécurité linguistique. En attestent aussi les approches de l’accent comme résultat d’une discrimination de traits phoniques (« [d]e manière générale, l’accent ne peut être compris et défini que s’il y a quelque chose auquel il peut être comparé » (Lippi-Green, 2019 [2012]), ou comme une source de discrimination, sociale, ethnique, professionnelle (Entre autres : Gasquet-Cyrus, 2012 ; Prikhodkine, 2019).
Accent : un objet partagé
La question des accents, appréhendée en relation avec des processus sociaux tels que la distinction, le conformisme, l’innovation, l’imitation, la stylisation, la loyauté, l’authenticité ou la discrimination, etc. en fait un objet d’étude pluridisciplinaire pour les sciences du langage, et notamment pour une sociolinguistique qui cherche à articuler les formes langagières avec ces différents processus sociaux, en s’intéressant à la fois aux pratiques, à leurs perceptions et aux représentations ou aux idéologies langagières. Mais c’est aussi un objet d’intérêt général comme le montrent plusieurs documentaires consacrés à l’accent (entres autres Drôles d’accent de Marc Khanne, Avec ou sans accent de Vincent Desombre, L’accent, c’est tendaaaaaance, du magazine de la TSR Mise au point) ou des initiatives comme la proposition de loi du député Euzet visant à « promouvoir la France des accents », acceptée par l’Assemblée nationale le 26 novembre 2020).
Accent et intelligibilité
Une dimension fondamentale de la notion concerne bien sûr la prononciation et ses liens avec l’intercompréhension au sein d’une langue donnée, dans son hétérogénéité. C’est pour cette raison qu’une partie du colloque APS22 sera commune avec la 7ème édition du colloque EPIP - English Pronunciation: Issues & Practices, organisé par des collègues anglicistes du LIDILEM, qui se préoccupent, dans une perspective didactique, de l’enseignement de l’anglais L2 en visant notamment à déconstruire le modèle du « locuteur natif », et à interroger les rapports entre accent « étranger », intelligibilité et intercompréhension. L’idée est ainsi d’organiser un évènement scientifique international qui rapproche deux communautés travaillant sur des objets connexes, avec des approches et des préoccupations en partie communes, mais dialoguant assez peu. Les deux colloques seront mutuellement accessibles aux participant·es qui le souhaitent, et partageront une demi-journée au cours de laquelle auront lieu une conférence plénière et une table ronde communes.
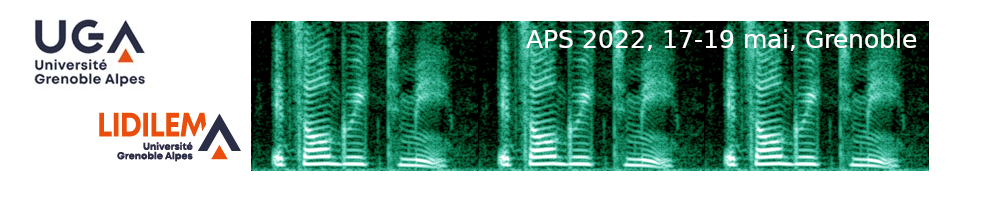
Calendrier
- 1er appel à communication : 31 mai 2021
- 2ème appel : 6 septembre 2021
- Deadline soumissions : 3 octobre 2021
- Transmission pour évaluation des propositions : 10 octobre 2021
- Deadline remise évaluations : 23 décembre 2021
- Sélection des communications : > 15 février 2022
- Notification d’acceptation/refus : 28 février 2022
- Publication programme : fin mars 2022
Plus d'informations