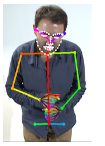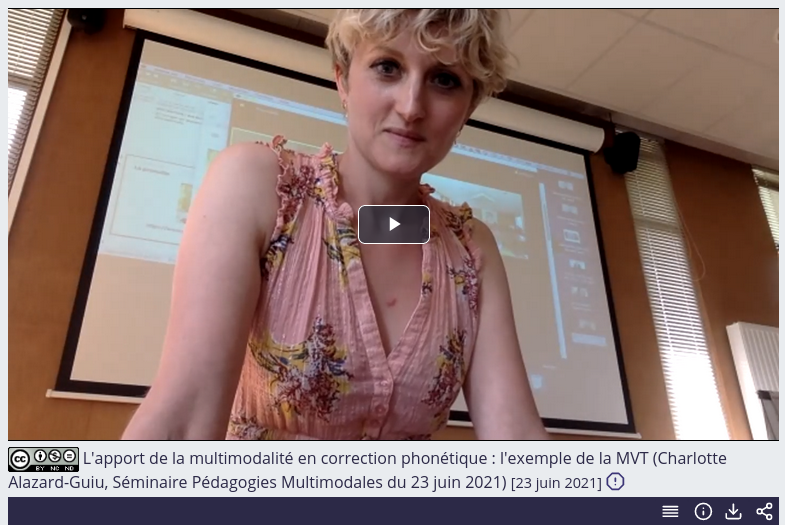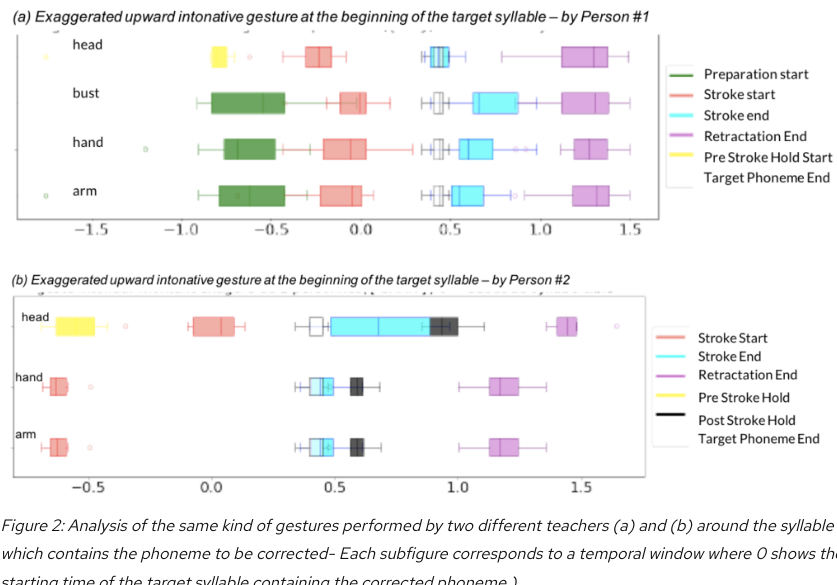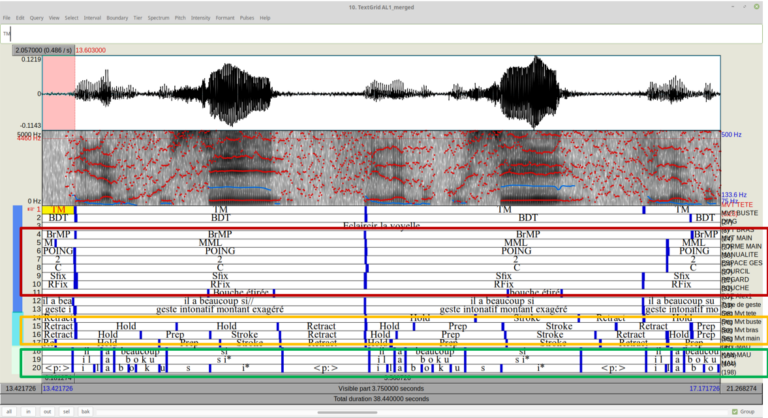Séminaire
Le 8 juin 2021
Adam Wilson, Université de Lorraine, IDEA
Microcosme de la mondialisation : aspects et enjeux sociaux du langage dans le tourisme
La pandémie de covid-19 souligne à quel point le tourisme, loin d’être une activité triviale ou superficielle, est central au fonctionnement de notre monde contemporain. Ce constat n’a rien de nouveau pour certaines branches des sciences humaines et sociales qui montrent depuis longtemps que le tourisme constitue une activité fondamentale pour un grand nombre d’individus, pour diverses communautés et pour l’économie mondiale (cf. Cohen 1972 ; Nash et al. 1981 ; Cousin & Réau 2009 ; par ex.).
Depuis une vingtaine d’années, un nombre croissant de recherches donnent à voir l’importance cruciale des éléments linguistiques, discursifs et sémiotiques dans toute activité, expérience ou industrie touristique (cf. Thurlow & Jaworski 2010 ; Moïse 2011 ; Jaworski et al. 2014 ; Held 2018). Dans ce séminaire, je m’appuierai sur ces études, ainsi que sur plusieurs travaux de terrain effectués dans le cadre de mes recherches, afin d’explorer la pertinence, et le potentiel, du milieu touristique pour les recherches sur les aspects et enjeux sociaux du langage.
Pour ce faire, je me focaliserai sur deux dynamiques sociolinguistiques de l’activité de consommation qui sous-tend le tourisme (Urry 1995). Dans un premier temps, j’explorerai les éléments langagiers et discursifs de la « commodification » en milieu touristique (Heller et al. 2014), c’est-à-dire la transformation de lieux, d’identités et de cultures en produits consommables. Dans un deuxième temps, je montrerai en quoi certaines politiques linguistiques et pratiques langagières semblent être liées à une recherche d’« efficience », une optimisation de la communication par rapport au temps et à l’effort dépensés, afin de faciliter la consommation (Wilson 2020). Ensemble, ces analyses me permettront de montrer en quoi la « mise en tourisme » d’un endroit peut mener à la valorisation (ou pas) de certaines langues ou variétés, contribuant à une (re)configuration spécifique des marchés linguistiques, entraînant des répercussions sociales vastes, et notamment de nouvelles formes d’inégalité et de ségrégation sociales.
En guise de conclusion, je montrerai en quoi les phénomènes étudiés nous permettent d’explorer les manières dont les pratiques langagières et politiques linguistiques en milieu touristique reflètent, et alimentent, certaines dynamiques idéologiques, politiques, économiques et sociales dominantes. Enfin, j’identifierai certaines similitudes et différences entre le tourisme et d’autres contextes « globalisés » afin d’ouvrir une discussion sur le statut du tourisme comme métaphore du monde social de nos jours (Dann 2002).
Références
Cohen, E. (1972). Toward a Sociology of International Tourism. Social Research, 39(1), 164‑182.
Cousin, S., & Réau, B. (2009). Sociologie du tourisme. La Découverte.
Dann, G.M.S. (éd) (2002). The Tourist as a Metaphor of the Social World. CAB International.
Held, G. (Éd.). (2018). Strategies of Adaptation in Tourist Communication. Brill.
Heller, M., Pujolar, J., & Duchêne, A. (2014). Linguistic commodification in tourism. Journal of Sociolinguistics,
18(4), 539‑566.
Jaworski, A., Thurlow, C. & Heller, M. (éds). (2014). Sociolinguistics and tourism [Special Issue]. Journal of Sociolinguistics, 18(4).
Moïse, C. (2011). L’économie mondialisée et le tourisme : Un domaine à explorer pour la sociolinguistique francophone ? Mondes du Tourisme, 4, 4‑17.
Nash, D., Akeroyd, A. V., Bodine, J. J., Cohen, E., Dann, G., Graburn, N. H. H., Hermans, D., Jafari, J., Kemper, R. V., LaFlamme, A. G., Manning, F., Noronha, R., Pi-Sunyer, O., Smith, V. L., Stoffle, R. W., Thurot, J. M., Watson-Gegeo, K. A., & Wilson, D. (1981). Tourism as an Anthropological Subject [and Comments and Reply]. Current Anthropology, 22(5), 461‑481.
Thurlow, C., & Jaworski, A. (2010). Tourism Discourse—Language and Global Mobility. Palgrave Macmillan.
Urry, J. (1995). Consuming Places. Routledge.
Wilson, A. (2020). Normes interactionnelles globalisées et communautés de pratique discontinues : Les dynamiques sociolinguistiques du tourisme international. Glottopol, 33, 113‑132.
Grigory Kunichkin (Lidilem)
Modalités linguistiques et graphiques de construction et d'expression de masculinités par les utilisateurs de l'application de rencontres gay Grindr
Les applications de rencontres représentent un terrain de recherche permettant d’étudier les nuances de communication entre hommes homosexuels ; c’est un espace où les hommes négocient leurs masculinités entre eux (Rodriguez et al. 2016 : 249). L’observation directe des profils des usagers des applications de rencontres (Grindr, Hornet et PlanetRomeo) destinées aux hommes homosexuels en France et en Italie relève l’abondance des hash-tags #viril, #masculin, #vraimec, #paseffiminé, #horsmilieu, #pasdeprincesse, #pasdefolles (#dominazione), des présentations de soi comme Viril, Discret et masculin, Uniquement pour vrais mecs (Bel ragazzo maschile, MeXXXL, Uomo normale, Solo per tori attivi, Pisellone) et des descriptions du partenaire souhaité comme Je cherche un vrai mec 100%, Cherche discret masculin, Les efféminés passez votre chemin, Pas de pute (Cerco Master seri, Cerco dominazione). Ces quelques exemples prouvent que l’identité de l’homme « masculin/viril » est importante pour les deux communautés homosexuelles. Les applications de rencontre sont des « maisons-des hommes » où les utilisateurs construisent et expriment leur masculinité : « […] la maison-des-hommes, dans sa version occidentale, est une institution avant tout immatérielle et labile, qui est opérante dans l’ensemble du corps social et effective de façon adaptative. On la retrouve sur le terrain de foot, ses gradins et ses vestiaires, dans certains bistrots, mais aussi dans la solitude du visionnage du porno… [...] » (Welzer-Lang, Mathieu et Faure, 1996, cité par Thomas Guenichon, « La prison et ses hommes » dans « Masculinité, état des lieux », sous la direction de D. Welzer-Lang, Ch. Zaouche Gaudron, Editions érès, 2011, Toulouse).
En présentant des extraits des profils personnels des utilisateurs de l’application, je parlerai des modalités qui permettent de construire et d’exprimer la masculinité par des utilisateurs de l’application Grindr : des modalités linguistiques servent à s’auto-présenter comme masculin, viril ; la masculinité liée au rôle sexuel, à la domination ; la masculinité qui rejette l’homme considéré comme efféminé ou bien, au contraire, l’accepte. A côté des modalités linguistiques, il existe celles graphiques représentées sous formes d’émojis : ce moyen constitue un langage à part pouvant, lui aussi, contribuer à la construction de la masculinité.
Références bibliographiques
Cantarella, E. (2018 [2007]). L’amore è un dio. Milano : Giangiacomo Feltrinelli Editore.
Cantarella, E. (2016 [1988]). Secondo natura. La bissessualità nel mondo antico. Milano : Giangiacomo Feltrinelli Editore.
Colin, G. (2016). La vie homosexuelle à l’écart de la visibilité urbaine. Ethnographie d’une minorité sexuelle masculine dans la Drôme. Tracés. Revue de Sciences humaines, №
30, 79-102. Repéré à
http://journals.openedition.org/traces/6424.
Connell, R. (2014), Masculinités. Enjeux sociaux de l’hégémonie. Paris : Editions Amsterdam
Greco, L. (2012). Un soi pluriel : la présentation de soi dans les ateliers Drag King. Enjeux interactionnels, catégoriels et politiques. Dans N. Chetcuti, L. Greco (éds.). La face cachée du genre (p.63-83). Paris : Presses Sorbonne nouvelle.
Le Talec, J.-Y. (2018). « Les Ours et la Lady. Ethnographie d’un rassemblement bear à Sitges (Espagne) », L'Homme & la Société, 2018/3 (n° 208), p. 117-141. DOI : 10.3917/lhs.208.0117. URL :
https://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2018-3-page-117.htm (consulté le 9 mai 2020).
Rodriguez, N.S., Huemmer, J. & Blumell, L.E 2016. Mobile Masculinities : An Investigation of Networked Masculinities in Gay Dating Apps. Masculinities and Social Change.
5(3). 241-267. (Repéré à
http://doi.org/10.17583/MCS.2016.2047).
Reynolds, Ch. 2015. ).“I Am Super Straight and I prefer You be Too” : Constructions of Heterosexual Masculinity in Online Personal Ads for “Straight” Men Seeking Sex With Men, Journal of Communication Inquiry, 39(3). 213-231. (Repéré à
https://doi.org/10.1177/0196859915575736).
Welzer-Lang, D. (2013 [2009]). Nous, les hommes. Essai sur le trouble actuel des hommes. Paris : Éditions Payot et Rivages.
Welzer-Lang, D, Zaouche Gaudron, Ch. (dir.). (2011). Masculinités, état des lieux. Toulouse : Editions Érès.
Welzer-Lang, D. (2008) [2004]). Les hommes et le masculin. Paris : Éditions Payot et Rivages.