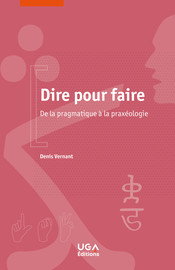DéLiCorTAL : Des linguistes à l’hôpital : le projet DECLICS
13h30 - 15h30
Saint-Martin-d'Hères - Domaine universitaire
Amphi 5, batiment Stendhal
Paul Cappeau, Poitiers-FORELLIS
Pendant 4 ans, des linguistes, venus de plusieurs champs disciplinaires, ont pris l’hôpital comme terrain d’enquête. Ils ont exploré, sous différents éclairages scientifiques, un corpus constitué d’entretiens authentiques. D’un point de vue linguistique, l’objectif était de problématiser les paroles échangées. D’un point de vue sociétal, il était attendu de sensibiliser les professionnels de la santé et les étudiants en SHS à des questions de langue et d’écoute.
Les principales questions auxquelles nous avons essayé de répondre sont :
- Quelle sont les caractéristiques linguistiques des médecins et des patients quand ils échangent ?
- La façon de dire les choses pourrait-elle provoquer quelque hiatus dans la communication ?
- Le choix d’une forme linguistique engagerait-il un effet sur le patient ?
- A quoi peut-on relier le sentiment d’incompréhension et d’absence d’écoute, souvent exprimé par les patients ?
Ce projet a donné des pistes pour dresser un pont entre la recherche fondamentale et la « recherche-action ». En remettant la parole au centre de l’attention, les linguistes devraient trouver une légitimité dans la formation aux métiers de la santé. C’est pourquoi le travail s’est toujours préoccupé d’une restitution didactique ou pédagogique.