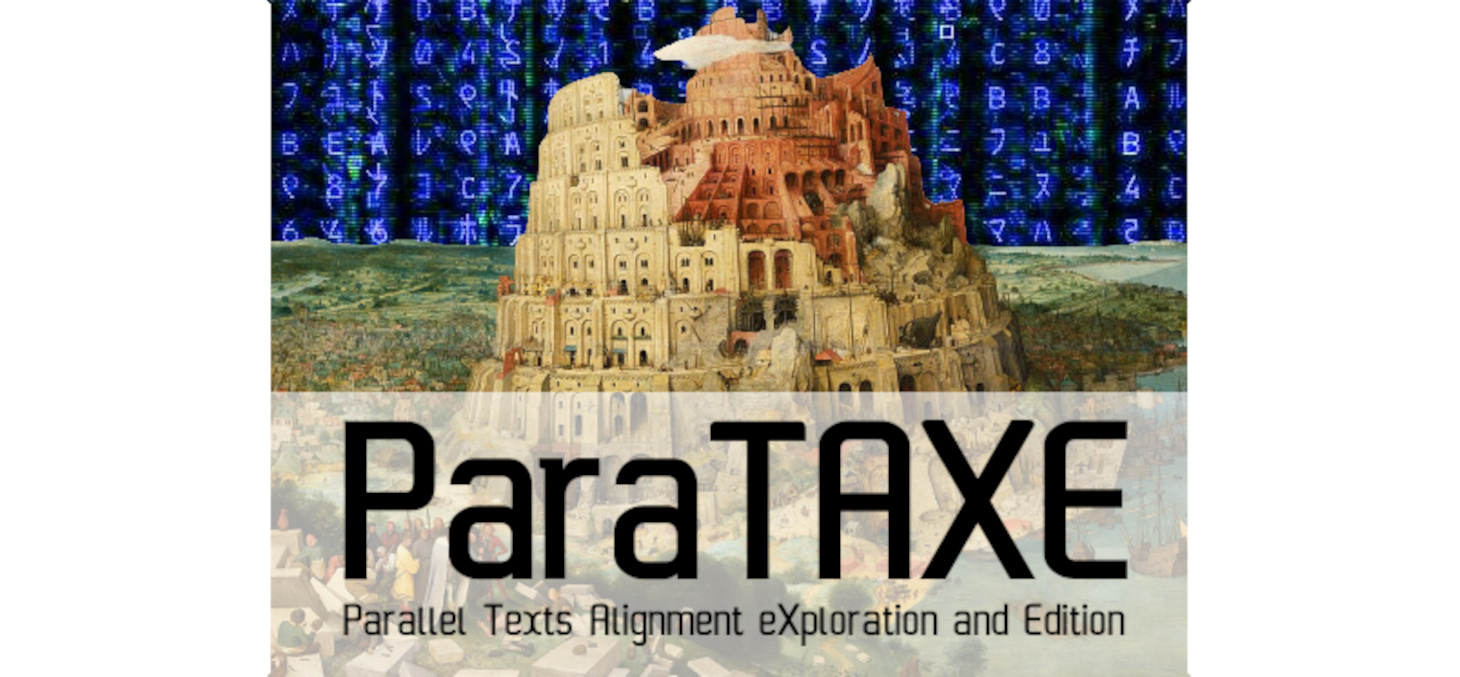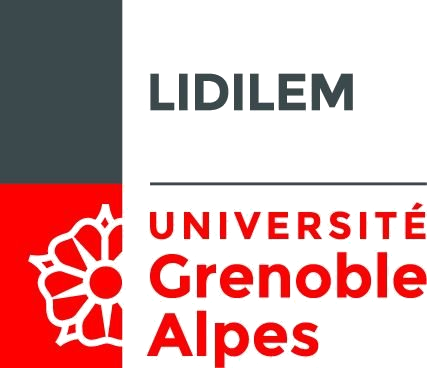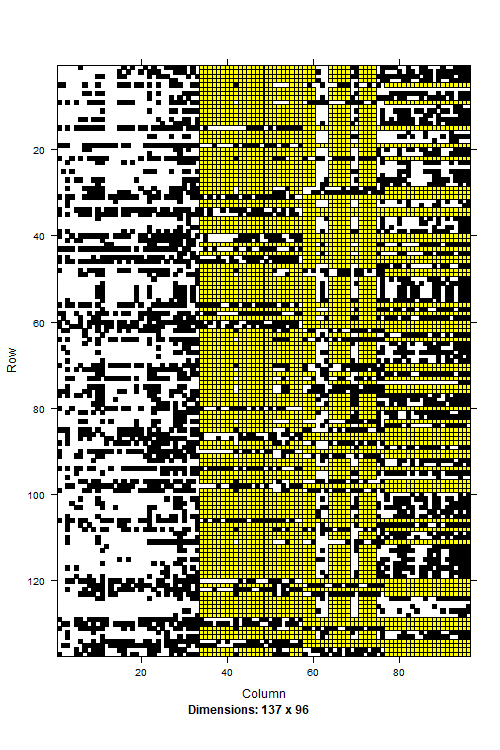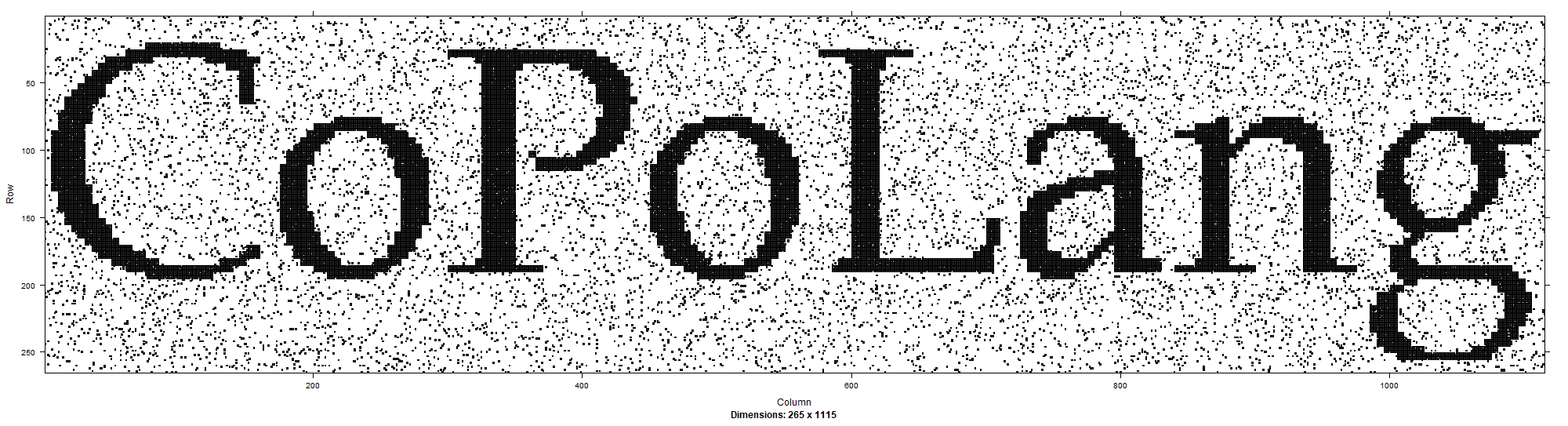Recherche
Hybrid Workshop: in person at Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania, Mihail Kogalniceanu Street, no. 1, room D. D. Rosca 1st floor and online

The Philosophy Department of the Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca (Romania) and the LiDiLEM Laboratory, Univ. Grenoble Alpes is co-organizing a workshop entitled "Direct interaction, methods of research, epistemology, and conceptualization”.
June 2nd – 4th, 2022
Hybrid event hosted by the Dept. of Philosophy of Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca in the central building of the university, M. Kogalniceanu street, No 1, 1st floor.
Working languages: French and English
The purpose of this workshop is to question the methods of research and investigation and the epistemological models that underlie the models of description and understanding of what is at stake in an interaction. We want to combine the conceptualizations and methodologies at work in the study of various forms of interaction: human-human, human-animal, human-machine, etc. We therefore invited researchers in philosophy, language sciences, psychology, conversational analysis, etc. who work on interactions to present their "work in progress", to propose it for collective reflection during a three-days exchange.
A few questions will be worked on:
- What is an interaction? How do you define it in your field? Is it a concept or just a word?
- Which are your analysis tools?
- What theoretical models of interaction are you employing and how can these models be used to understand what is at stake in an empirical interaction?
Working papers
Invited speakers
Working methods
The workshops will take place in 3 stages:
- a summary by the moderator (15 min)
- a time of reaction, complement, .... by the contributors of the workshop (10 min per person)
- a general discussion with all the participants (45 min)
The programme
Thursday, June 2nd, 2022
10am-10.30am: Welcoming the guests
10h30 – 12h00 Keynote lecture
Gaëlle Ferré – FoReLLIS, Université de Poitiers (France), Les gestes d’attention conjointe dans les interactions multimodales
12h00 – 13h30 Lunch break
13h30-15h00 Workshop No1 Chairperson: Jean-Pascal Simon Diaporama introductif
1. FLOREA Ligia Stela, Professeur de linguistique française à l'Université de Cluj-Napoca, Roumanie, Directions de recherche sur l'interaction
2. BOUCHARECHAS Manon, Doctorante, Lab. LiDiLEM, Université Grenoble Alpes, France, L’interaction en didactique du FLE : du concept reliant aux défis méthodologiques
3. DURUS Natalia, ZIEGLER Gudrun, BLANCA Philippe, multi-LEARN Institute for Interaction and Development in Diversity asbl, Luxembourg, Apprendre en contexte de migration : la réalisation interactionnelle du terrain commun
15h00 -15h15 Pause
15h15 – 16h45 Workshop No2 Chairperson: Anamaria Curea
4. GEORGE Clotilde, doctorante en Sciences du Langage, Laboratoire : ATILF, Université de Lorraine, France, « Petit ou grand café ? » : Quelques questionnements liés à l’analyse d’un acte langagier saisi dans une temporalité large en contexte de formation professionnelle exolingue
5. VARGA Claudia, counsellor, St. Dimitry Center, Cluj-Napoca PhD student, Faculty of History and Philosophy, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca & COPOERU Ion, Dept. of Philosophy, Babeş-Bolyai University Cluj-Napoca, Interactions as source of the change of behavior in addiction and recovery from addiction. An exploratory study
6. MANNO Chiara, Doctorante, laboratoire MoDyCo - UMR 7114 Université Paris Nanterre, France, Mise en regard d’interactions issues de langues éloignées
7. LANDOLSI Houda, Chercheure postdoctorale, Université d’Uppsala, Suède et Lab. ICAR, Lyon, France, De l’hétéro-reformulation à la pseudo-reformulation. Interaction verbale et argumentation dans un débat télévisé sur l’identité et l’intégration
Friday June 3rd, 2022
9h00 – 10h30 Workshop No3 Chairperson: Hélène Maire Diaporama introductif
8. DASCALU Ileana, assistant, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Interaction and Imagination in Philosophical Training
9. FOURNEL Anda, chercheure postdoctorale, Lab. LiDiLEM, Université Grenoble Alpes & PERRET-CLERMONT Anne-Nelly, Pr. émérite, Institut de psychologie et éducation, Faculté des lettres et sciences humaines, Université de Neuchâtel, Suisse, Construction de problèmes communs dans l’interaction. Une mise en discussion du thème « croire savoir » par des collégiens et leurs enseignants
10. CIOFLEC Eveline, lecturer, Philosophy, Lucian Blaga University, Sibiu, Romania, Direct Interaction and Belonging
10h30 – 10h45 Pause
10h45 – 12h15 Workshop No 4 Chairperson: Ion Copoeru Diaporama introductif
11. BOTAN Vanessa, Université de Lincoln, IONESCU Thea, Université de Cluj-Napoca, Roumanie, Fernando, The University of South Australia, Lidia Grigoriu, Université de Cluj-Napoca, Roumanie, Embodied learning: The role of gesture-based interactions in language acquisition
12. PETRISOR Mihai-Alexandru, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania, Is interaction just a dynamical process?
13. MAIRE Hélène, Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN, UR 7489), Université de Lorraine, France, CHARAFEDDINE Rawan, Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN, UR 7489) et Equipe TRAJECTOIRES, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, CNRS (UMR 5292), INSERM (UMR-S 1028), Université Lyon 1, Lyon, France & VAN DER HEST Jean-Baptiste Equipe TRAJECTOIRES, Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon, CNRS (UMR 5292), INSERM (UMR-S 1028), Université Lyon 1, Lyon, France., L’interaction et ses ratés : une approche par l’embarras et la honte
12h15 – 14h00 Lunch break
14h00-15h30 Workshop No 5 Chairperson: Thea Ionescu Diaporama introductif
14. BRIEDIS Mindaugas, Pr., Université Mykolas Romeris, Lithuanie, Interactions in Image-Based Medicine: From the Intersubjective Encounter with Technology to the Constitution of Individual Professional Skills
15. FAICIUC Lucia, Phd & Senior researcher at the Romanian Academy, Cluj-Napoca Branch, Psychology Research Group, Roumanie, A nonlinear dynamic approach of the notion of interaction
16. MIRANDA MEDINA Juan Felipe, Universidad Católica San Pablo, Pérou, Interaction in Challenge: A Semiotic Approach to Afro-Peruvian Zapateo
15h30 -15h45 Pause
15h45 – 17h15 Keynote lecture
Michael Baker, Directeur de Recherche au CNRS en sciences du langage, UMR CNRS - Télécom Paris, Questions épistémologiques - théoriques - méthodologiques de l'analyse des interactions verbale (titre provisoire)
Saturday, June 4th, 2022
9h00 – 10h30 Workshop No 6 Chairperson : Mindaugas Briedis Diaporama introductif
17. PROPERZI Martina, Ph.D. (Philosophy), International Area on Foundations of the Sciences, Pontifical Lateran University of Rome, Italie., Meaningful Human-Machine Interaction: Some Suggestions from the Perspective of Augmented Intelligence
18. ZEBROWSKI ROBIN L., Professor of Cognitive Science, Departments of Philosophy, Psychology, and Computer Science Beloit College, WI USA, Mutual Incorporation, Intercorporeality, and The Problem of Mediating Systems
19. KOSMALA Loulou, PhD linguistic, Université Sorbonne nouvelle, France, Rethinking (dis)fluency within the scope of interactional linguistics and gesture studies: introducing the model of inter-fluency
10h30 – 10h45 Pause
10h45 – 12h15 Round table
12h15-12h30 Closing of the workshop